Gens de l’Amérique
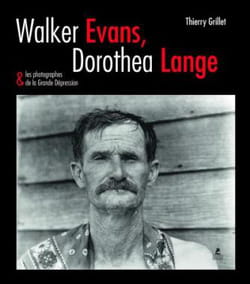
A voir ces photos réquisitoires, il semble que les mots de Marion Post Wolcott (1910-1990), une des photographes qui figurent dans ce bel ouvrage, soient la première et la meilleure légende qui puisse les accompagner toutes: « Faites parler vos images avec votre cœur et votre âme ». Des photos pour certaines largement diffusées et exploitées mais dont l’attrait pourtant ne s’use pas. Parce qu’elles portent comme un sceau d’humanité qui, apposé par l’objectif sur chacune d’entre elles, leur donne une charge émotive, poétique, authentique. Pas de distance qui fausserait le regard, au contraire, il s’établit une proximité de sincérité avec ces bâtisseurs de ponts, ces mineurs qui éclairent les ombres de leur visage par un sourire viril, ces cultivateurs courbés dans les champs, ces femmes qui malgré l’indigence veillent aux soins des enfants. Marion Post Wolcott, « en guerre photographique », suit les errances, les attentes et les lassitudes au plus près, cadre dans l’instant où elle est surprise la vérité des attitudes.
Adoptant une approche plus engagée socialement de ses sujets, prenant des angles qui servent sa démarche, Dorothea Lange dénonce la précarité et la dureté des conditions de vie des pionniers, des migrants, des déshérités noirs et blancs de l’Amérique de la Grande Dépression et de la crise de 1929 qui, selon les mots de Thierry Grillet, « a couché l’Amérique sur le bas-côté ».

On lit en même temps Les raisins de la colère de John Steinbeck quand on tourne lentement ces pages où s’éclaire dans toute son étendue le cliché dans une esthétique à la fois forte, subtile, presque spiritualisée par ces visages rapprochés, ces objets dérisoires qui accompagnent les jours d’efforts et les années de labeur des émigrés venus de loin, voyageant avec tous leurs biens, s’installant sous un pont à Marysville en Californie ou luttant contre le désert environnant au Texas. Ils croyaient en une Amérique pour tous, ils découvrent un univers impitoyable où ils n’ont pas leur place. Le discours de cette grande artiste est celui du militant qui se révolte avec l’arme qu’il possède, un appareil photo. Pour témoigner. En jouant sur les contrastes, en captant le moment où intervient le destin, Dorothea Lange restitue dans le dénuement la dignité des hommes, des femmes, des enfants qui avancent dans leur aventure à mesure qu’ils marchent sur les longues routes américaines.
De son côté, Jack Delano, ayant quitté la Russie au moment de la révolution et arrivé en 1923 aux Etats-Unis, unissant « la lumière, la couleur, la texture », produit des vues très artistiques où l’honnêteté prime, selon son souhait de « faire les portraits de travailleurs, de gens ordinaires avec la même compassion et le même souci de comprendre que ceux que Van Gogh avait témoignés face aux paysans avec son pinceau et ses brosses ».

Identique combat des personnages chez Russell Lee (1903-1986), qui en retenant la solitude, évoque celle qu’Edward Hopper a peinte dans des milieux différents, celui-ci en couleurs, celui-là en noir et blanc. A quelques années près, ils vivent les mêmes scénarios d’un pays qui se transforme et documentent l’évolution sociale, urbaine, architecturale. La sobriété avec laquelle ils observent la réalité est d’une éloquence absolue. Avec Russell Lee, les images de devantures où la marque Coca Cola impose déjà son célèbre graphisme, de petit-déjeuner réchauffé le long de la route, de fillette qui repasse les effets élimés de ses frères, rejoignent par leur puissance visuelle les reportages poignants dans l’Oklahoma d’Arthur Rothstein.
L’ouvrage débute avec Walker Evans * qui notait : « Ce dont je ne cesse de parler dégage une pureté, une rigueur, une immédiateté qui s’obtiennent par absence de prétention à l’art, dans une conscience aigüe du monde ». Il fixe sur la pellicule le revers d’une Amérique de légende. Quand Evans, qui est venu à Paris alors âgé de 23 ans et a lu Baudelaire et Flaubert, photographie les rues de New-York, les passantes à Bethlehem, un vieux couple de Virginie-Occidentale, les gens de l’Alabama, on sent qu’il a en mémoire les clichés d’Eugène Atget qui immortalisait les transformations de Paris. Son propos est clair. Il constate, évite l’émotionnel, préserve l’anonymat.

Ces drames des existences qui se manifestent par des files d’attente pour obtenir de la nourriture et des enfants sans souliers, se révèlent dans leur profondeur parce qu’ils sont vécus en profondeur. Rien de surfait. Walker Evans enregistre ainsi « un monde sans gloire et sans vanité », comme le dit justement l’auteur, directeur de la Diffusion culturelle de la BNF, qui introduit un à un, avec des textes brefs mais essentiels pour les comprendre, les chapitres consacrés aux photographes qui parcoururent l’Amérique pour le compte de la Farm Security Administration, l’organisme créé en 1937 afin de venir en aide aux fermiers pauvres. Pour l’œil d’aujourd’hui, toutes ces vues sont considérées désormais, pour leur dimension esthétique et humaine, comme autant d’icônes.
Dominique Vergnon
Thierry Grillet, Walker Evans, Dorothea Lange et les photographes de la Grande Dépression, Editions Place des Victoires, 279 pages, 280 illustrations, 27x31 cm, mai 2017, 29,95 euros.
* A signaler la première grande rétrospective consacrée à l’œuvre de Walker Evans qui se tient actuellement au Centre Pompidou ; jusqu’au 14 août 2017 ; www.centrepompidou.fr





0 commentaire