"Moi, Claude Empereur", réédition de la série de la BBC
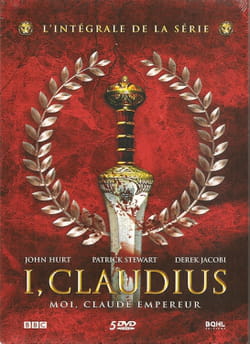
Réédition chez BQHL de la série de la BBC sur les débuts de l’empire romain Moi, Claude Empereur. Vieux machin ? Peut-être. Mais un classique n’est jamais vraiment vieux.
Si vous êtes un fan des séries Rome ou Spartacus, le coffret de cinq dvd de la série Moi, Claude Empereur n’est peut-être pas fait pour vous. Point de sang qui vous gicle au visage. Point de nudité non plus. C’est que, voyez-vous, la chose date d’il y a trente ans et qu’en ce temps-là, ma bonne dame... Ajoutez un manque de moyens ahurissant, en tout cas ahurissant pour nous en 2015 (puisque désormais la moindre série B se vautre dans des débauches de CGI), dans toute l’entreprise, du premier au dernier épisode. La caméra reste figée : où irait-elle, la pauvre, quand les décors semblent ne jamais dépasser dix mètres carrés ? Lorsqu’elle se hasarde à sortir, elle montre seulement un coin de rue, jamais une rue entière. Un personnage assiste-t-il à un spectacle de cirque ? Nous ne verrons rien du spectacle ; nous le devinerons à travers le regard du personnage. Certes, c’était la méthode que Chaplin avait employée pour l’Opinion publique — on ne voyait pas le train, mais seulement les reflets des vitres du train sur le visage de l’héroïne restée sur le quai —, mais là où Chaplin proposait une véritable mise en scène, Moi, Claude Empereur rappelle l’ascétisme grotesque, tout de contre-plaqué vêtu, des balbutiements de certaines séries télévisées anglo-saxonnes des sixties et des seventies qui ne se sont jamais imposées en France — Star Trek ou Dr. Who par exemple. Les maquillages censés marquer le vieillissement des personnages sortent d’une boutique de farces et attrapes. Précisons enfin que les couleurs sont souvent aussi délavées qu’un jean trempé dans l’eau de Javel.

En outre, la sensation d’étouffement amenée par l’étroitesse des décors touche au cœur même du sujet. Certes, l’empire romain s’impose à coups d’expéditions et de batailles tout autour de la Méditerranée, mais c’est aussi à l’intérieur même des murs du palais qu’il se dessine. Le non-initié se perd aisément dans l’arbre généalogique de ces mâles et de ces femelles qui ne cessent de se séduire, de se trahir, de s’étriper et de s’empoisonner les uns les autres pour succéder à Auguste ou pour faire parvenir au pouvoir leur candidat favori, mais ce Who’s Who de psychopathes se compose finalement d’une petite cinquantaine de personnes. La thèse suggérée au hasard de certaines répliques semble d’ailleurs être qu’il est très difficile de rétablir une république, quand bien même on le souhaiterait sincèrement, dès lors qu’on a contribué à mettre en place un régime autocratique qu’on pouvait imaginer temporaire.
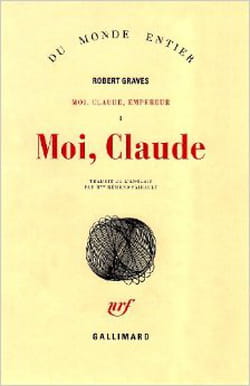
L’histoire du cinéma vient elle-même illustrer ce principe d’incertitude : le coffret contient parmi les bonus un documentaire intitulé The Epic That Never Was, sur le film que Joseph von Sternberg voulut tirer du roman de Graves dès 1936 et commença même à réaliser, mais dont le tournage, pour diverses raisons, fut définitivement interrompu. Les bonus de cette édition incluent en outre une interview érudite, mais très pince-sans-rire, de Michel Eloy, qui maintient vivace la flamme sacrée de Vesta sur son site http://www.peplums.info. Cette réédition d’I Claudius a été pour nous l’occasion d’un entretien avec lui sur la situation du péplum aujourd’hui. Comme on le verra dans cet entretien et dans l’historique du télé-péplum qu’il nous a aimablement concocté, si courtes que soient les questions, les réponses de Michel Eloy sont toujours longues lorsqu’il évoque l’Antiquité grecque et latine au cinéma. Ah ! ces spécialistes…
FAL
P.S. — Signalons, pour les amateurs de ce que les Anglo-Saxons appellent trivia, que Sian Phillips, interprète de Livie, fut mariée pendant vingt ans à Peter O’Toole, lequel a interprété de son côté le rôle d’Auguste dans une autre production télévisée — Augustus, the First Emperor. (C’est Charlotte Rampling qui, dans cet Augustus, tenait le rôle de Livie.)
Pour commencer, un peu de cuisine éditoriale. En quoi ce coffret, publié par BQHL, diffère-t-il de la version qu’avait publiée précédemment Antartic Video ?
Michel Éloy <> Victime de la crise du dvd et des téléchargements pirates, il semble bien qu’Antartic Video ait mis la clé sous le paillasson après trente-trois ans d’activité. Les droits d’I Claudius (Moi Claude, empereur) ont alors été repris par BQHL, éditeur qui semble très actif dans la diffusion de séries télévisées, de films d’arts martiaux mais aussi de films gay (www.bqhl.com/index.php/catalogsearch/result/?q=claudius).
Henri Lenique — maître d’œuvre de l’édition Antartic — avait fait du beau boulot au niveau des bonus. L’édition néerlandaise DFW (Dutch FilmWorks), précédemment parue en 2002, n’en contenait qu’un seul, The Epic That Never Was (70’42"), un docu BBC commenté par Dirk Bogarde, évoquant la tentative avortée d’une adaptation à l’écran du roman de Robert Graves par Josef von Sternberg. Outre la V.O., l’édition Antartic 2006 proposait comme bonus les « Scènes favorites » (36’15"), la remise des Awards (8’7") et un second docu BBC, I, Claudius : A Television Epic (prod. & réal. Paul Vanezis, 2002) (73’45").
La réédition 2011 y rajouta une interview de votre serviteur par Marc Toullec, « Moi, Michel Éloy» (38’46"). Lenique voulait un « plus » ; je lui avais suggéré ce commentaire historique, mais je ne suis en aucun cas responsable du titre qui lui a été donné !
Dans la réédition BQHL, la remise des Awards et le docu de P. Vanezis ont disparu, sans doute pour des questions de droits. Dommage.
Ce télé-péplum, qui se déroule pratiquement tout le temps en huis-clos, n’est-il pas le contraire des péplums de cinéma, où régnaient les grands espaces ? Est-il plus fidèle à la réalité historique ou multiplie-t-il les licences poétiques ?
Claude et « les grands espaces » ? Il a conquis la Grande-Bretagne, mais n’y a mis les pieds que quand tout était joué et n’y demeura que quinze jours... Ses généraux avaient fait tout le travail.
A la différence du Roi des Celtes (1972) ou de l’Aigle de la IXe Légion (1976), axés sur l’aventure et l’action et destinés à un public jeune, Moi Claude vise des téléspectateurs plus adultes, plus attirés par la psychologie ou les coulisses de l’Histoire ; en fait, c’est du théâtre filmé. Je crois bien que l’unique « extérieur » se passe en Germanie sous la tente de Drusus agonisant (on doit entrevoir un bout de paysage germanique par la tenture entrebâillée). A l’occasion d’un combat de gladiateurs, la caméra ne filme que la loge impériale, la bande son suggérant que des combattants s’affrontent dans une arène que l’on n’entrevoit même pas. J’imagine que le réalisateur, Herbert Wise, a dû composer avec des contraintes de temps et de budget.
Au niveau des licences poétiques, le romancier a sans doute noirci le personnage de Livia, à qui il attribue systématiquement toutes les morts suspectes survenues dans la famille julio-claudienne. On ne prête qu’aux riches ! Sans doute, pour porter au pouvoir son fils Tibère, a-t-elle bien dû se rendre coupable de quelques crimes, mais pas de tous, quand même ! Donc Livia est une « méchante » parfaitement assumée, telle qu’on les aime ! La thèse de Robert Graves était que Claude, délibérément, s’était fait passer pour idiot, afin d’échapper aux soupçons des ambitieux avides du pouvoir. C’est possible, mais on n’en sait rien.
Mais la série prend à son tour des libertés par rapport au roman. Par exemple, avec l’assassinat de Drusilla par son frère Caligula au cours d’un rituel sado-maso. Caligula aimait profondément sa sœur. D’une passion incestueuse, tout comme ses deux autres sœurs Livia et Agripinilla (Agrippine-la-Jeune, mère de Néron). Pourtant, on admet que le règne de Caligula — qui démarra dans les meilleures conditions — ne s’infléchit qu’après la mort de Drusilla, victime d’une maladie... (cf. la pièce de Camus).
La décision de tourner une série télévisée à partir des ouvrages de Graves est-elle liée à l’époque à laquelle elle a été prise ?
Qui peut le dire ? Le roman de Robert Graves est, en trois livraisons, paru entre 1934 et 1935. Joseph von Sternberg a voulu le porter à l’écran dès 1937, mais le tournage fut interrompu par un accident d’automobile dont Merle Oberon fut la victime.
Je constate que, assez curieusement, deux grandes gloires de la littérature britannique traitant de l’antiquité romaine ont été adaptées pour le petit écran pratiquement simultanément par cette même BBC 2 (Scotland). En 1976, donc, la BBC 2 adapte Moi Claude de Robert Graves (diffusion : 20 sept.-6 déc. 1976) ; ensuite, elle enchaîne avec l’Aigle de la IXe Légion (Eagle of the Ninth) d’après le roman de Rosemary Sutcliff (1954). Un classique de la littérature pour ado, en Grande-Bretagne, qui, de fait, concerne directement l’Écosse puisque c’est dans les Highlands que — selon la légende — se serait perdue la fameuse légion IX Hispana.
Tournée par Michaël Simpson & Baz Taylor, cette seconde adaptation fut diffusée en septembre 1977. Autant que je sache, elle est restée inédite en France et en Belgique francophone (elle n’a été diffusée que sur une chaîne néerlandophone).
Le roman de R. Sutcliff a récemment fait l’objet de deux adaptations cinématographiques. L’une hardiment revendiquée, l’Aigle de la IXe Légion (Kevin Macdonald, 2010). L’autre simplement, mais très clairement « inspirée », Centurion / The Ninth Legion (Neil Marshall, 2009).
Quelle est exactement la place de Robert Graves dans la littérature touchant à la Rome antique ?
Je me suis encore offert il y a deux ans Adieu à tout cela (Good-Bye to All That, 1929). Graves (1895-1985) y raconte ses souvenirs de jeunesse, dont sa participation à la Première guerre mondiale, et notamment à la bataille de la Somme où — capitaine dans l’infanterie — il fut blessé. Adolescent, j’avais dévoré sa Toison d’Or (1944) ; puis Lawrence et les Arabes (1927), le Comte Bélisaire (1938), King Jesus (1946). Rayon essais, même si je prends avec les plus grande réserve ses théories sur le matriarcat, ses Mythes grecs (1955) trônent sur ma table de chevet, et aussi ses Mythes hébreux (1964), mais j’ai du mal avec sa Déesse Blanche (1948), car la littérature celtique m’est moins familière que la gréco-latine.
Graves aurait contribué au scénario des Amazones de Terence Young (1974).
Claude est-il un benêt passif assez peu cinématographique ou doit-on, à l’inverse, considérer que sa position de spectateur favorise l’identification du téléspectateur ?
C’était déjà son attitude dans le roman, présenté comme ses mémoires : Claude raconte l’histoire de sa famille pour qu’on la redécouvre deux mille ans plus tard. En somme, Robert Graves se conformait à sa source principale, la Vie des Douze Césars de Suétone, un grand journal « people » avant la lettre. Suétone, le « montreur de César », était un fonctionnaire au service de la dynastie usurpatrice des « Antonins », dont la période est néanmoins considérée comme l’âge d’or de l’Empire romain. Pour autant, il ne faudrait pas prendre les déclarations de leurs thuriféraires pour paroles d’Évangile. Ils avaient les meilleures raisons au monde de noircir les Julio-Claudiens et les Flaviens (même Jules César et Auguste en prennent pour leur grade). Circonstance aggravante, le Christ aurait été crucifié sous le règne de Tibère et les premières persécutions auraient débuté sous Néron. En réalité, on n’a jamais retrouvé ces fameuses lois néroniennes, ce qui est étonnant quand on se souvient de l’addiction des Romains pour le domaine juridique. En l’occurrence, Pères conscrits et Pères de l’Église se sont rencontrés pour les discréditer — ce pour la plus grande délectation des cinéphiles.
Les textes des historiens contemporains de l’époque ont tous disparus, ou nous sont parvenus sous une forme frelatée. Le livre XV des Annales de Tacite (55-115), qui relate l’incendie de Rome et la persécution des chrétiens, ne nous est connu que par des copies tardives, sorties des écritoires de nos bons moines.
On ne sait rien de sérieux sur Caligula, ce qui autorisa le romancier américain Lloyd C. Douglas, dans son roman la Tunique (1942), à montrer cet empereur, qu’il rebaptise bizarrement « Gaius Drusus Agrippa », persécutant les chrétiens [1]. Plus soucieux d’édification religieuse que de scrupules historiques (les membres de la famille julio-claudienne échappaient à son entendement), ce fils de pasteur n’avait d’autre ambition que de rajouter une relique de plus aux innombrables reliques christiques [2], la fameuse Tunique sans coutures (Jn, 19 : 23)...
Donc après « Suétone, le montreur de Césars », c’est au tour de Graves de nous les montrer, puis à son adaptateur télévisuel — qui rajoute une couche au passage — de nous les montrer à son tour. Au moment de sa sortie, le roman avait fait scandale. La série télévisée eut le même effet, du moins dans un premier temps. Ne pas faire de Claude le spectateur de sa propre vie aurait été une trahison du roman. Mais cette mise en abîme donne le vertige.
Le docu BBC I, Claudius : A Television Epic (visible uniquement dans les éditions Antartic 2006 & 2011) est une sorte de making of, mais seulement axé sur le jeu des acteurs. On y découvre notamment le rôle déterminant de Robert Erskine dans la supervision de ceux-ci. Soyez méchants avec les esclaves, qui ne sont que des outils à votre service. Quand ils vous servent, ne les regardez ni ne les remerciez... Derek Jacobi s’apprêtait à jouer Hamlet au théâtre, le rêve de toute une vie, quand on lui proposa d’incarner Claude. Le scénariste, Jack Pullman, était surtout connu comme auteur de comédies. Cherchant ses points de repères, Siân Phillips se demanda si elle ne devait pas considérer Moi Claude comme une Jewish comedy. Voilà qui donne une idée de l’état d’esprit qui régnait sur le plateau.
Une ambiance délétère régnait sur cette famille ancêtre de la « Famille Adams », pleine de personnages malveillants cherchant à se faire trébucher les uns les autres. A commencer par Livia, qui manie les poisons en experte et est déterminée à éliminer quiconque pourrait faire obstacle à son fils Tibère. Lequel Tibère, qui ne désire nullement devenir empereur, souffre de ne pas être reconnu et aimé par son beau-père Auguste [3], est constamment en conflit avec sa mère et s’oppose à l’ambition sans bornes de celle-ci (qui veut régner à travers lui). Et il y a la méchanceté de Caligula, jubilant sur le lit de mort de son arrière-grand-mère Livia, qu’il baise sur la bouche ; son hystérique danse du soleil, avec des atours dignes de ceux d’une strip‑teaseuse ; et surtout sa conviction que le crime le rapproche du divin. Inceste, parricide, tout lui est délectation.
Même l’austère et honnête Antonia participe au criminel délire familial, puisqu’elle punit sa fille Livilla en la faisant emmurer vivante en expiation de ses crimes (elle a empoisonné son mari Castor, pour les beaux yeux de son amant Séjan) [4]. Les Romains ne badinaient pas avec les grands principes !
Cette série Moi Claude n’est-elle pas très datée aujourd’hui ?
Moi Claude n’a pas été coulé dans le moule d’un blockbuster classique. S’il est ringard de ne pas assister à des orgies avec des esclaves nu(e)s, des batailles épiques, des catastrophes envoyées par les dieux, des galériens flagellés, Moi Claude est effectivement une série ringardissima. Mais pourquoi cracher dans la soupe ? Nous avons notre pesant de folie furieuse et de morts par empoisonnement. Arsenic et vieilles dentelles, n’est-ce pas... so British ?
Quels sont les péplums présentés au cinéma ces deux dernières années qui vous ont semblé marquants ? Mad Max 4 est-il un péplum ?
Rien de très exceptionnel depuis le superbe Agora (Alejandro Amenabar, 2010). Deux — non, trois Hercule en 2014, suivis d’Exodus bien sûr, qui contient une réflexion géopolitique, mais qui n’est pas ce que Ridley Scott a fait de mieux. Et enfin Noé de Darren Aronofsky (pas mauvais).
J’avais adoré 300 de Zack Snyder, même s’il était plus mythologique qu’historique, avec ses hoplites spartiates combattant non pas en armure, ce qui eût été plus judicieux, mais en « nudité héroïque », comme on dit en histoire de l’art. Mais par sa surenchère, la séquelle 300 — Rise of an Empire m’a cueilli un peu à froid. Thémistocle passant d’une trière à l’autre sur son cheval noir, comme un cavalier roquant sur un échiquier. Soit. Artémise est assez conforme à ce qu’en a dit Hérodote, sauf bien sûr sa sexualité exacerbée. Mais tant au cinéma que dans les bandes dessinées, les héroïnes-guerrières au vagin exubérant sont très tendance.
Pour Mad Max 4, il faudrait d’abord s’entendre sur un point : l’heroic fantasy relève-t-elle du péplum ; et Mad Max 4 relève-t-il encore de l’heroic fantasy ; n’est-ce pas plutôt de la science-fiction ? Les films post-apocalyptiques cultivant la brutalité et une pseudo-gladiature, façon Hunger Games, c’est un peu — sinon complètement — borderline... Je le dis en toute sérénité, même si quantité de péplums ne se sont pas gênés pour s’installer à califourchon sur les genres.
De votre lointaine Belgique, avez-vous suivi les remous français sur la question de l’enseignement du latin et du grec ?
Pour en avoir discuté avec des professeurs de langues anciennes — tant en France qu’en Belgique —, je déplore cette espèce de « nivellement par le bas » qui ne laisse rien présager de bon. Un peuple sans passé est un peuple sans avenir.
La Grèce et Rome constituent la clef de voûte de notre identité non seulement européenne, mais aussi méditerranéenne. Henri Salvador pouvait — et non sans raison — se moquer de « nos ancêtres les Gaulois », mais le Salon littéraire ne rappelait-il pas il y a quelques semaines l’importance de Lucien de Samosate, récemment réédité ? Lucien écrivait en grec, mais n’oublions pas qu’il était Syrien. Il faut préserver ce précieux héritage, témoin du rêve d’universalité d’Alexandre le Grand, puis de l’Empire romain qui lui a succédé.
Y a-t-il dans votre bonus une chose essentielle que vous n’ayez pas pu dire ?
Il n’en était pas question à l’époque où j’ai enregistré ce bonus, mais puisque que vous venez d’évoquer ma belgitude...
Il s’agit de cette problématique du « roman historique » qui me taraude l’esprit. Où s’arrête le respect de l’Histoire (en supposant que tous les historiens soient entre eux d’accord) et où commence la « licence poétique » de l’auteur ? Une minisérie en cinq épisodes, Albert II (Frank van Mechelen, 2013), vient de sortir sur un de nos petits écrans francophones (RTL-TVI). Inspiré par l’exemple de Beatrix (TV néerlandaise), cette série évoque la succession de notre roi Baudouin par son frère cadet Albert, lequel, après vingt ans de règne (1993-2013), a voici deux ans abdiqué en faveur de son fils Philippe. Cette mini-série a été tournée à l’époque, le tournage ayant démarré plusieurs mois avant l’abdication du souverain, avec des acteurs très populaires en Flandre, mais parfaitement inconnus à Bruxelles et en Wallonie. Imaginez le bug : Leah Thys, qui incarne la psychorigide reine Fabiola était, en Flandre, connue surtout pour sa participation à des shows humoristiques comme le « soap » Thuis.
Après la Seconde Guerre mondiale, la Flandre catholique avait permis le retour du roi Léopold III — suspect de complaisance avec l’occupant nazi — contre l’avis de la Wallonie « anti-léopoldiste », plutôt socialiste (sinon communiste). Le deal étant que son fils Baudouin monterait sur le trône dès sa majorité (1951), l’intérim étant entre-temps assuré par un Régent. Aujourd’hui, ce sont les Wallons (attachés au maintien de l’État belge) qui sont les plus ardents défenseurs de la monarchie, contre les nationalistes flamands qui sont plutôt républicains.
Je lis dans la presse que la minisérie est historique à 50 %, et fictionnelle autant. « Cela pourrait être l’histoire de notre famille royale », suggère prudemment le trailer RTL. Que son scénariste, Willem Wallyn, n’hésite pas à la qualifier de « Muppet Show », me laisse rêveur. Il s’agit de personnes encore en vie, et même sur le trône ! De fait, le scénariste aura dû meubler entre les moments connus du public par les médias, et imaginer ce qui a ou aurait pu se dire entre quatre z’yeux (par exemple les consultations du roi avec son premier ministre ne peuvent être révélés par celui-ci). Or rien ne prouve que l’avis d’Untel, dans l’intimité et selon le film, corresponde réellement à ses pensées, à son attitude.
Alors je reviens à Moi Claude : les Julio-Claudiens sont surtout connus par les indiscrétions de cette pipelette de Suétone, largement considéré comme un fouille-poubelle. Robert Graves a développé, et le scénariste Jack Pullmann en a rajouté une couche. Moi qui ne suis ni pro‑ ni anti-royaliste, mais respecte la fonction, j’en ai entendu de toute les couleurs ces trente dernières années sur les royales « turpitudes » vraies ou supposées. Des vertes et des pas mures. Ce qui est agréable avec Moi Claude, c’est que cette peinture aux traits forcés — c’est la loi de l’entertainement ! — n’éclabousse pas ma vie de simple citoyen de ce pays.
Propos recueillis par FAL
[1] Portée à l’écran en 1953 (la Tunique, Henri Koster), avec une séquelle en 1954 (les Gladiateurs, Delmer Daves). Au cinéma, sous la plume de scénaristes un peu moins incultes, ce Drusus Agrippa « redevient » Caligula : inoubliable prestation de Jay Robinson en fou psychotique.
[2] La lance de Longin ; les clous de sainte Hélène ; le bois de la Vraie Croix ; le saint Suaire de Turin ; la couronne d’épines conservée à Notre-Dame de Paris) ; le Saint Graal du Cycle arthurien...
[3] Livia avait eu deux fils : d’un premier lit, Tibère, l’aîné ; puis d’Auguste, Drusus, le cadet.
[4] Dans le bonus Scènes favorites, différents intervenants de la série évoquent la séquence dont ils ont gardé un bon souvenir. Derek Jacobi/Claude : Caligula annonce à Claude qu’il est un dieu, et même un dieu supérieur puisqu’il a commis plus de crimes et incestes que les autres dieux. — Siân Phillips/Livia : empoisonne Martina... l’empoisonneuse. — Herbert Wise/réalisateur : Séjan propose à Claude de devenir son beau-frère ; la mort d’Auguste. — Christopher Biggins/Néron : Agrippine s’offre à son fils. — George Baker/Tibère : exilé à Rhodes avec son astrologue Thrasyllus, il apprend la mort de Lucius — John Hurt/Caligula : guéri, Caligula exige la mort du courtisan Lentulus qui avait proposé sa vie en échange de celle de l’empereur à l’agonie. — Brian Blessed/Auguste : accuse les sénateurs d’avoir tous couché avec sa fille Julie. — Amanda Kirby/Antonia la Jeune, mère de Claude : dénonce à son fils le complot de Séjan.
***********************************************************************
Historique du Télé-Péplum
par Michel Eloy
Dès les années cinquante, les chaînes de télévision américaines ont porté au petit écran divers épisodes de l’Antiquité. Ainsi par exemple sur NBC, The Hallmark Hall of Fame (« Lydia » [1], 1955 ; « Give Us Barabbas ! », 1961 ; « Caesar and Cleopatra », 1976). Ou sur CBS You Are There (« The Assassination of Julius Caesar », 1953 ; « The Death of Cleopatra », 1953 ; « The Burning of Rome », 1954). Dans un registre plus fictionnel, rappelons la série SF Au Cœur du Temps (Time Tunnel, Irwin Allen, 1966) qui au fil des épisodes évoquait divers moments historiques, dont plusieurs sur l’Antiquité comme la Guerre de Troie (Revenge of the Gods), la tombe de Néron (The Ghost of Nero) ou les trompettes de Jéricho (The Walls of Jericho), le tout rehaussé de nombreux stock-shots empruntés au cinéma.
Avec les moyens qui étaient les leurs, la Grande-Bretagne, mais aussi la France ont évidemment suivi. Ainsi sommes-nous redevables à Pierre Tchernia d’un premier brouillon télévisuel d’Astérix live avec Deux Romains en Gaule (1967).
Pour ce qui est des grandes séries, en 1967, aux États-Unis, Joe Levine développa avec ABC un projet qui ne dépassa pas le stade du pilote (Hercules and the Princess of Troy, avec Gordon Scott). C’est l’Italie, sauf erreur, qui fut pionnière avec l’Odyssée (Franco Rossi, 1969), avec Bekim Fehmiu, suivie par l’Énéide (1971) du même réalisateur, avec Giulio Brogi. En 1982-1983 il fut encore question, pour Rossi, de compléter la trilogie en tournant une Iliade, mais cela resta lettre morte.
Il faut encore signaler, pour l’O.R.T.F. et ses partenaires, fin 1967, un projet de série télévisée d’après la BD de Jacques Martin « Alix ». Un pilote tiré des Légions perdues, « L’Épée de Brennus », aurait dû être tourné dans les anciens décors de la Chute de l’Empire romain, près de Madrid. L’affaire ne se fit pas, l’éditeur Louis Robert Casterman voyant d’un mauvais œil la part prise par le coproducteur américain dans la franchise (il était notamment question de rebaptiser la série « Alix » en « Marcus le Romain »). Depuis lors, « Alix » a fait l’objet d’une série d’animation par Jean Cubaud (1998).
En 1972, Le Roi des Celtes (Arthur, Warlord of the Britons) (Sidney Hayers, et al.) s’efforça de dépouiller le merveilleux du mythe arthurien pour ne conserver qu’un tableau terre-à-terre de ce que fut la Bretagne face aux incursions des Saxons, après le retrait de Rome. Une sorte de « Thierry-la-Fronde » brittonique. Cette série précéda de peu Moi Claude (1976), la première grande saga télévisuelle sur Rome [2], que le producteur Martin Lismore concoctait depuis près de six ans déjà.
Suivirent : Moïse : Les Dix Commandements (Moses, the Lawgiver) (Gianfranco De Bosio, 1975) ; Jésus de Nazareth (Franco Zeffirelli, 1977) ; l’Ancien Testament (The Greatest Heroes of the Bible) (James Conway, 1978 [15 ép.]) ; Masada (Boris Sagal, 1980) ; la série d’animation mythologico-SF Ulysse 31 (Bernard Devries & Jean Chalopin, 1981), coproduction franco-japonaise ; les Derniers Jours de Pompéi (Peter Hunt, 1983) ; Anno Domini (Stuart Cooper, 1984) ; Quo Vadis ? (Franco Rossi, 1984) et quelques autres séries inédites chez nous ou avortées (on ne sait trop ce qu’il est advenu d’une série qui devait être consacrée aux différentes reines Cléopâtre d’Égypte [3]).
Bon gré, mal gré, la télévision française suivit le mouvement par le biais de téléfilms ou d’épisodes de miniséries. Esclave et Pharaon (Patrick Meunier, 1985) ; le Sacrifice (Patrick Meunier, 1988)... Les Évasions Célèbres a proposé un épisode « Attale, l’esclave gaulois » (1986) de Jean-Pierre Decourt, sur un scénario d’Henri de Turenne, d’après Grégoire de Tours [4]. La même année, revisitant les classiques du déduit, la Série Rose de Pierre Grimblat nous a valu une aristophanesque Lysistrata (« La Grève de l’amour », Nino Monti). Cette série repasse régulièrement aujourd’hui sr AB3 vers 3h du matin.
Années quatre-vingt-dix
Ainsi s’achevèrent les eighties, Troisième Âge d’Or du péplum, placé sous la triple égide, sur le grand écran, des caligulades érotiques et de l’heroic fantasy post-apocalyptique (Conan, Mad Max), et, sur le petit, des séries qu’on vient d’évoquer.
Elles ne s’effacèrent que pour laisser place, dans les années quatre-vingt-dix, à deux grandes sagas atypiques, moitié mythologiques, moitié fantasy : Hercule (The Legendary Journeys of Hercules, 4 saisons, 5 téléfilms & 116 épisodes, 1994‑1998) et son spin‑off, Xena la Princesse Guerrière (Xena Warrior Princess, 6 saisons, 134 épisodes, 1995‑2001). A quoi il faut ajouter d’autres séries dérivées (Young Hercules ; Cleopatra 2025).
Marqua également cette décennie la superbe série la Bible (La Bibbia) produite par Lube entre 1994 et 2002 (quatorze épisodes, ou peut-être un ou deux en plus) et retraçant les grands moments de l’Ancien et du Nouveau Testament depuis la Création jusqu’à l’Apocalypse. Il y eut encore, pour un public plus jeune, Roar : la Légende de Conor (1997), série australienne imaginant les Romains en Irlande, avec le maléfique centurion Longin qui — quatre siècles auparavant — avait de sa lance percé le flanc du Christ.
Après Gladiator
1. Les séries TV
Vient ensuite le Quatrième Âge d’or, le « Post-Gladiator » principalement caractérisé d’une part par le retour sur les grands écrans de films de bonne tenue et, sur le petit, de nouvelles sagas (Empire, ABC, 2005 ; Rome, HBO-BBC, 2005‑2007 [2 saisons] ; Spartacus, Starz, 2010-2013 [4 saisons]), mais aussi par un genre assez nouveau : le docufiction. Deux sagas aux intitulés presque identiques s’y distinguèrent : Rome : grandeur et décadence d’un Empire (Ancient Rome : The Rise and Fall of an Empire) (BBC-Discovery Channel, 2006 [6 ép.]) et Rome : Rise and Fall of an Empire (Gardner Films-History Channel, 2008 [13 ép.]). La saga britannique est de bon niveau, mais l’américaine souffre de sa planification économique. Toutes deux cependant abordent des épisodes romains rarement, pour ne pas dire jamais, traités par les péplums : les Gracques, Marius, le sac de Jérusalem, Caractacus, Stilicon, Majorien, etc.
Produite par la RAI, la série Imperium connut sur les écrans francophones un destin assez incertain avec les excellents : 1/ Augusto, Il Primo Imperatore (Roger Young, 2003) et 2/ Nerone (Paul Marcus, 2005). Il y eut d’autres titres annoncés, mais qui, semblent-ils, se perdirent dans les limbes.
À ces séries on peut évidemment en ajouter d’autres, notamment dans un registre parodique, comme la série britannique Plebs (Sam Leifer, 2013-2014 [2 saisons]) et la française Peplum (Philippe Lefebvre, 2015).
2. Les docufictions
Dans la même période de nombreux autres docufictions « unitaires » ont fleuri sur les petits écrans, tels le Dernier jour de Pompéi (Peter Nicholson, 2003) qui met en scène Pline l’Ancien, que Bulwer-Lytton avait négligé d’introduire dans son célèbre roman ; Gladiateurs (Tilman Remme, 2003) ; Meurtre à Rome (David Stewart, 2005), reconstitution du Pro Roscio, procès plaidé par Cicéron — une production BBC Channel avec participation de FR3 ; Hannibal, l’ennemi de Rome (Richard Bedser, 2005) ; l’Atlantide : fin d’un monde, naissance d’un mythe (Tony Mitchell, 2011). Et bien d’autres encore…
Une mention spéciale pour Brûlez Rome ! (Robert Kéchichian, 2005), docufiction français s’appuyant sur les travaux de l’universitaire toulousain Robert Sablayrolles relatifs aux vigiles, qui étaient les pompiers de Rome.
Un autre Français, Fabrice Hourlier, s’est illustré dans le même registre avec le Destin de Rome (2011), sur le triangle César-Antoine-Cléopâtre, et Au nom d’Athènes (2012), sur les Guerres médiques, avec dialogues en latin, en grec et — au moins pour le second titre — en farsi.
3. Les téléfilms et la vidéo
Enfin, n’oublions pas les téléfilms. Car ces années 2000 ont également vu, aux États-Unis, des sociétés comme Hallmark [5], Asylum ou New Horizon diffuser sur Sci-Fi Channel toutes sortes de productions B ou Z destinées à la télévision ou au marché de la vidéo. Quelques échantillons sont arrivés de ce côté-ci de l’Atlantique (certains de bon niveau historique, d’autres complètement « décomplexés », et parfois franchement grotesques) : Games of Rome : les Jeux de l’Empire (Amazons and Gladiators) (Zachary Weintraub, 2001) ; Jules César — Veni, vidi, vici (Uli Edel, 2002) ; Hélène de Troie (John Kent Harrison, 2003) ; Légions : les guerriers de Rome (Boudica, Warrior Queen) (Bill Anderson, 2003) ; Spartacus (Robert Dornhelm, 2004) ; les Dix Commandements (Robert Dornhelm, 2006) ; Pompéi (Pompei, ieri, oggi, domani) (Paolo Poeti, 2007) ; Odysseus, voyage au cœur des Ténèbres (Ulysse et l’île des Brumes) (Terry Ingram, 2008) ; la Chute des Empires (Le Cyclope) (Declan O’Brien, 2008) ; le Roi Scorpion 2 — Guerrier de Légende (Russell Mulcahy, 2008) ; la Traversée des Enfers (Hellhounds) (Rick Schroder, 2009) ; Ben Hur (Steve Shill, 2010) ; Kingdom of Gladiators (Stefano Milla, 2011) ; le Roi Scorpion 3 (The Scorpion King 3 : Battle for Redemption) (Roel Rainé, 2011) ; ou the ultimate daube : Morituris : Legions of the Dead (Raffaele Picchio, 2012). Ou encore, dans le sillage des pelli-Hercules de Renny Harlin avec Kellan Lutz et de Brett Ratner avec Dwayne Johnson, Hercule : la Vengeance d’un Dieu (Hercules Reborn) (Nick Lyon, 2014).
[1] Condamné à mort, saint Paul est sauvé par une femme.
[2] En Grande-Bretagne diffusée entre le 20 septembre et le 6 décembre 1976 sur BBC 2. En France, Moi Claude a été programmé sur Antenne 2 à partir du 7 juin 1978 ; rediffusé sur la même chaîne pendant l’été 1982 ; puis repris par TMC du 4 juillet au 15 août 1986.
[3] The Cleopatras (John Frankau, GB 1983 [5 ép.]).
[4] Avec Bernard Giraudeau dans le rôle de cet Attale, fils d’un sénateur burgonde, emprisonné par le roi Théodorik (Michel Vitold), dont son esclave Léon organise l’évasion (mort de Clovis, en 511).
[5] L’Odyssée (Andrei Konchalovsky, 1997) ; Merlin (Steve Barron, 1998) ; l’Arche de Noé (Noah’s Ark) (John Irvin, 1999) ; Cléopâtre (Franc Roddam, 1999) ; Marie Mère de Jésus (Kevin Connor, 1999) ; Jason et les Argonautes (Nick Willing, 2000) ; la Terre Promise (In the Beginning / Abraham le Prophète) (Kevin Connor, 2000) ; les Brumes d’Avalon (Uli Edel, 2001) ; l’Anneau sacré (Curse of the Ring) (Uli Edel, 2004) ; Hercule (Hercules. Half God. Half Man. All Power) (Roger Young, 2005).




0 commentaire