Pierre maraval, Les fils de Constantin : Déjà Byzance
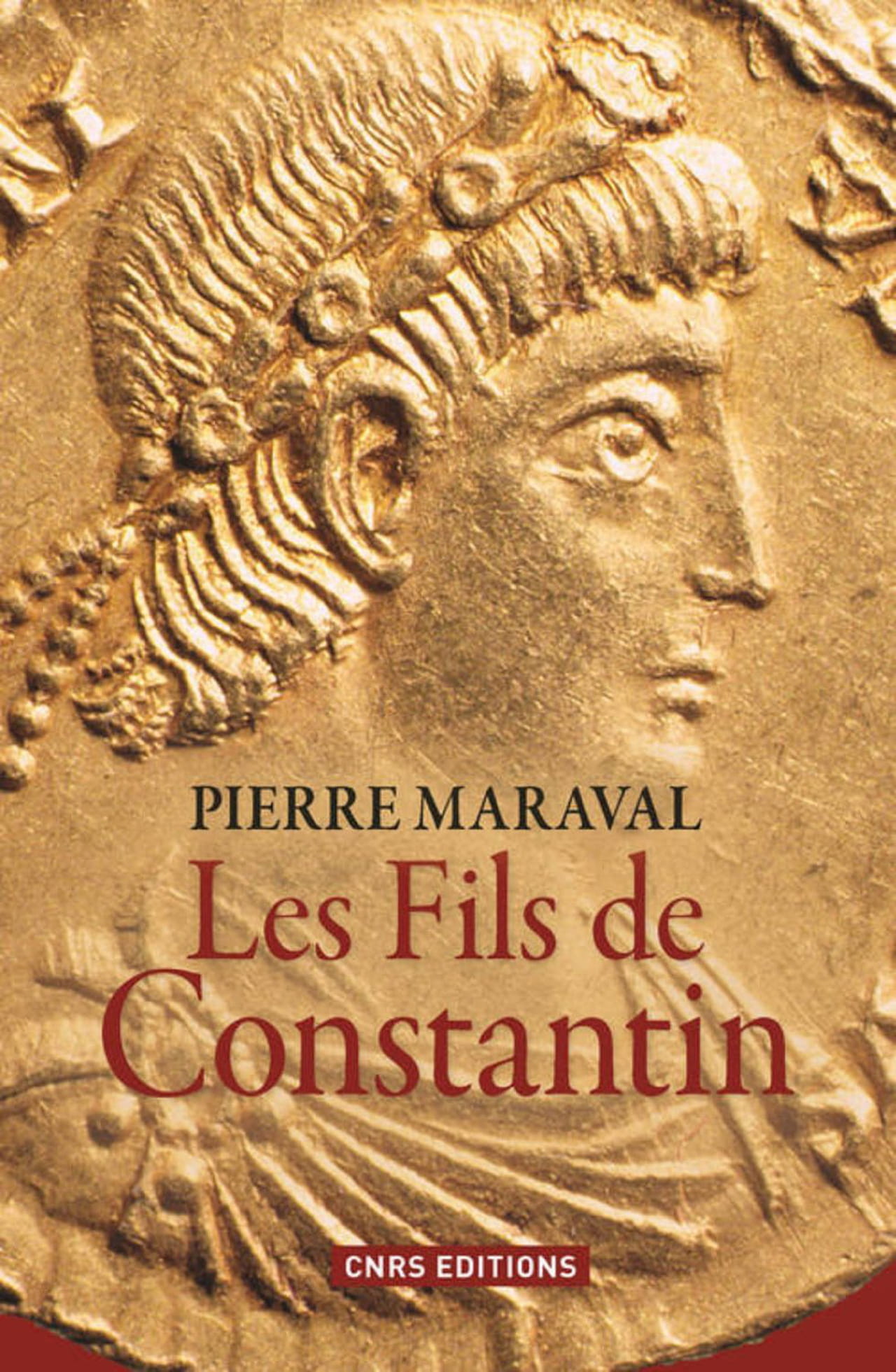
Pierre Maraval, spécialiste de l’antiquité tardive, nous avait déjà livré une brillante biographie de Constantin en 2011, insistant beaucoup sur la rupture que représenta sa conversion au christianisme. Car notre auteur est spécialiste du christianisme antique : on lui doit une somme, le christianisme des origines à Constantin, publié aux PUF. L’histoire de l’antiquité tardive, peu prisée des étudiants et inconnue du grand public, constitue néanmoins une des fondations de la civilisation européenne, voire du Moyen-Orient. Avec Les fils de Constantin, Pierre Maraval sacrifie, sans le savoir, à une mode, celle de la suite, si typique de notre époque. C’est en tout cas une occasion de jeter un coup d’œil sur des princes oubliés, vilipendés pour leur cruauté par leur cousin, Julien l’Apostat, dont la fortune historiographique fut immense (on doit à Lucien Jerphagnon une très bonne biographie de lui). Leur mauvaise réputation est en partie fondée : leur règne commence par un massacre digne des Atrides, celui de leur oncle Jules Constance, demi-frère de Constantin le grand, et de sa famille. Seul le futur Julien l’Apostat et son frère Gallus échappent à la mort. Comme circonstance atténuante, notons que Constantin le Grand fit exécuter son fils Crispus, possible amant de sa belle-mère : une famille pour le moins dysfonctionnelle, comme on dit aujourd’hui…
Un empereur et ses frères
Constance II profite des institutions mises en place par son père Constantin, développe l’administration palatine, favorise le sénat de Constantinople. Pour autant, il ne néglige pas Rome -qu’il visite- et son aristocratie, assume la fonction de Pontifex Maximus de la religion traditionnelle romaine. Dans ces années, les païens, encore majoritaires, doivent en effet être ménagés. Pour autant, l’Empereur a choisi son camp.
L’ascension du christianisme
Si l’adoption du christianisme comme religion officielle de l’empire interviendra trente ans après la fin du règne de Constance II, celui-ci la favorise déjà largement, en la dotant par exemple généreusement en terres. A l’instar de son père, il n’hésite pas à intervenir dans ses affaires intérieures, que cela soit dans le schisme donatiste en Afrique du Nord ou dans les querelles de l’arianisme. Elles paraissent surréelles au lecteur d’aujourd’hui notamment sur le rapport de dieu le fils à dieu le père (elles résultent pour beaucoup de la difficulté à transposer des mots grecs, langue de philosophe pleine de subtilités, au latin, langue d’administrateurs); elles démontrent en tout cas les débuts d’un « césaropapisme » cher à Gilbert Dagron où César n’hésite pas à s’impliquer dans la définition du dogme de l’église. En cela, Constance II prépare la voie à Justinien, Héraclius de tous les grands empereurs byzantins. Bravo à Pierre Maraval pour cette synthèse soufrant de quelques coquilles qui n’enlèvent rien au brio de l’analyse.
Sylvain Bonnet
Pierre Maraval, Les fils de Constantin, CNRS éditions, novembre 2013, 332 pages, 25 €


0 commentaire