Le pont de Ran-Mositar, Franck Pavloff tisse un monde perdu dans les stigmates de la guerre où ne demeure que la fine espérance dans l'humanité
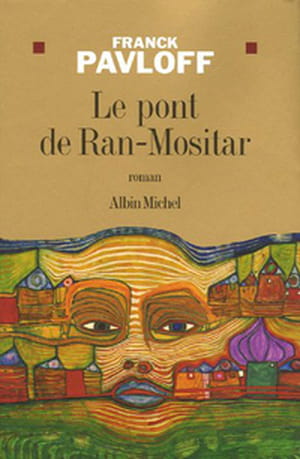
Symbole de ce lien rompu, le pont de Ran-Mositar, classé au Patrimoine mondial, enjambait les deux rives du fleuve pour permettre aux piètons devenus ennemis de garder un lieu, neutre parce que commun, au-delà des fondamentaux irreconciliables. Mais le pont a été détruit ; qui a tiré le premier ? chacun accuse l'autre camp, l'Histoire ne s'en remettra pas.
« Jusque-là, aucune faction n'avait osé s'attaquer au symbole du pont qui reliait les communautés […] Soudain la notion de crime contre le patrimoine de l'humanité s'inscrivait dans le livre de la barbarie. La ville avait retenu son souffle puis, dans un silence pétri d'angoisse, les habitants s'étaient approchés des rives séparées. L'incroyable blessure qui béait devant eux zébrait leur conscience d'une même cicatrice, les rendait responsable d'une inconcevable atteinte aux racines de la vie. »
A la fin du conflit, symbolique, il faut reconstruire le pont, tendre de nouveau ce lien fragile entre les hommes. Mais le faire à l'identique, par respect de ce qu'il fut...
Ce chantier attire les travailleurs, et les femmes rescapées y trouvent aussi un moyen de conquérir tout ce qui leur a été pris par les hommes, effacer par le labeur qui donne la liberté les viols et la mort des maris. Mais « l'arrêt du conflit n'avait pas gommé les haines », et l'entente tourne vide en « cohabitation de bouts de nerfs » : une phrase de travers, une petite plaisanterie dans unn pâtois, et ce sont les couteaux tirés... La guerre civile a été dévastatrice. C'est un très beau roman de la condition féminine en temps de guerre, et des efforts que les rescapées doivent fournir pour survivre dans un univers babare et masculin. Deux femmes s'entr'aident, reconstruisent un monde à leur mesure, les mains dans la boue du pont.
Descendu de la montagne et comme attiré par le pont, Schwara est mystérieux, il est maître artisans et solitaire, taciturne et profondément humain. Il secours les choses détruites, les ponts et les hommes. Mais il porte un lourd secret, fardeau de rancune et d'amour mêlés qui le pousse en avant, vers le pont qui l'unique lieu de l'après-guerre où, peut-être, sinon reconstruire du moins retrouver son existence. Son parcours est sineux, il marque chacune de ses étapes de signes et regarde, au loin, son passé aboli.
La misère de l'après-guerre et la promiscuité forcée ouvrent sur la découverte de l'autre : quand il n'y a plus rien, il faut survivre côte à côte loin des rancunes et des haines. Mais dans ce roman de la bêtise humaine égale de chaque côté de la frontière, la survit de l'humanité devient douteuse : le pont, qui reliait peuples, cultures et religions dans un effort commun, est l'actant essentiel de cette aventure où la vie même « survit » dans le cloaque boueux d'où sortira, pas l'union des forces communes, un espoir — peut-être — pour demain.
Suivant les deux parcours — les femmes, Schwara —, Franck Pavolf tisse un monde perdu où ne demeure qu'une fine espérance, celle de l'humanité au fond de l'homme. L'écriture est chargée, toujours émue et retenue au bord de la poésie, par un auteur qui ne veut pas imposer son combat, qui ne veut pas convaincre et entrer dans le jeu de la lutte, mais qui expose, qui peint, qui donne à réflechir. Qui fait, finalement, son travail d'écrivain.
Loïc Di Stefano
Franck Pavloff, Le pont de Ran-Mositar, Albin Michel, septembre 2005, 265 pages, 17,50 euros





0 commentaire