Que tous nous veuille absoudre ou les vestiges du jour
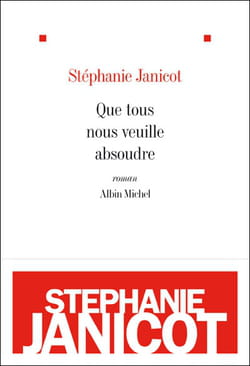 Ce beau roman, à la plume sensible et au verbe délicat, vibrant des infimes atermoiements des cœurs endeuillés, nous entraîne dans la banale mélancolie de quelques vies brisées ou ralenties par les hasards et les aléas d’existences qui n’allèrent pas jusqu’au bout des espoirs qu’on avait insufflés en elles. Stéphanie Janicot déroule le fil de douces années qu’on ne peut effacer et de jours amers qui s’égrènent au rythme d’une prophétie.
Ce beau roman, à la plume sensible et au verbe délicat, vibrant des infimes atermoiements des cœurs endeuillés, nous entraîne dans la banale mélancolie de quelques vies brisées ou ralenties par les hasards et les aléas d’existences qui n’allèrent pas jusqu’au bout des espoirs qu’on avait insufflés en elles. Stéphanie Janicot déroule le fil de douces années qu’on ne peut effacer et de jours amers qui s’égrènent au rythme d’une prophétie.Parole de Dieu, parole d’homme
Saar, l’héroïne, si tant est que ce terme puisse être adéquat, nous narre ses souvenirs lumineux en compagnie de son défunt mari, répondant au nom de Solel, en correspondance onomastique avec l’impression toujours renouvelée d’un soleil qui se lève sur la radiance de l’avenir. Il est passé le temps des joies et des amours, il est venu, celui de l’aigreur, du handicap, de la vieillesse prématurée, du deuil jamais éteint. Avec une infinie douceur et une discrétion jamais mélodramatique, l’auteur dépeint ce microcosme cantonné à la place de la Contrescarpe dans le cinquième arrondissement de Paris, et à la surface duquel affleure un je-ne-sais-quoi de religieux : une pharmacienne aux accents de sainte, sa fille un rien délurée qui finit par rencontrer la religion, son fils prodigue qui marche dans les pas de son père reporter (le fameux Solel ), un professeur de philosophie à la retraite qui parfait son imitation de Cioran mâtinée d’un soupçon kantien, la narratrice, et surtout le mystère du roman : le jeune garçon qui profère par sa bouche la parole terrible et intimidante des prophètes du désert. Il est venu parmi les hommes et les nations celui qui montrera l’iniquité, l’impudence, l’indécence des hommes ! Etranges et fascinantes prophéties incises dans le corps de la narration, échos sans cesse présents dans ce roman où presque rien ne se passe. Saar navigue dans les eaux troubles et douloureuses du Léthé anamnésique qu’est devenue son existence de femme brisée par un attentat à la bombe.
Dans le désert des hommes, celui de la solitude et des amours enfuies, où ne peuvent résonner que la parole des morts ou des augures, l’auteur distille à la fois le venin de la mélancolie et l’ambroisie de la tendresse. On ne rit pas, on ne pleure pas, on sourit à travers les larmes, tant le mot dans sa justesse et sa sobriété, servi par un style concis, parvient à toucher en nous quelque évocation de ces drames personnels que nous pouvons avoir vécus. Entre une visite à un éditeur, à un producteur de théâtre, à une artiste à la mode et une salade prise dans une brasserie, le temps de la narration se fragmente comme en une rêverie ; les heures, les jours, les saisons passent, et sans cesse l’on revient au drame initial, celui de la perte. Ce roman nous parle de la disparition, mais, quand bien même l’enfant-prophète affole les foules de la rue Mouffetard, la parole divine dans ce qu’elle peut avoir de plus intime, par-delà même la croyance ou l’appartenance à une foi précise, parvient à faire entrevoir une aurore à ce crépuscule des âmes.
« Frères humains, qui après nous vivez… »
Le titre, tiré de ce poème célèbre autant que déprimant de François Villon, nous dit sans ambages que face aux accusations de ces mystérieuses prophéties (mais qui trouveront dans le roman une explication si simple et peut-être si décevante qu’elle en devient transcendante par sa simple humanité) nous nous affolons et nous réfléchissons à nos engagements, à nos actes. La philosophie qui vise à servir autrui plutôt que soi, cette métaphysique de la morale, est proprement kantienne : le petit garçon ne dit-il pas s’appeler Imanouel, variante du prénom du célèbre penseur ? L’auteur pourtant ne sombre jamais dans la facilité ou la caricature. Pas de happy end mais pas de désespérance non plus : un humour diffus accompagne par la parole de Saar la narratrice le portrait souvent cocasse de ces êtres un rien mécaniques ou absolus dans leurs décisions. Ce n’est pas le philosophe admirateur de Cioran qui accomplira l’irréparable suppression de soi. Le malheur se cache, tapi parfois dans les tréfonds des âmes que l’on veut croire les plus fortes. Rien n’est simple dans le tumulte si insignifiant aux yeux des prophètes et si magnifiquement exacerbé dans la perpétuation du souvenir qui nous entraîne vers l’accomplissement du deuil. Telle est la leçon de Stéphanie Janicot, qui parvient dans un roman assez bref à aborder toutes les figures de la famille, les avatars des mères et des pères dont l’humeur et le comportement varient. La mise en abyme est particulièrement subtile lorsque la narratrice nous décrit la pièce de théâtre qu’elle écrit : on la voit, on la devine, on croirait la lire, et finalement on s’aperçoit qu’on est en train, précisément, de lire l’explication profonde de cette pièce, qui dans le paradigme du roman, n’expose qu’une extériorité inaccessible à la perception réduite des personnages.
Alors, que raconte cette histoire ? Simplement le cheminement de la lumière vers l’ombre et de l’ombre vers un timide lever de soleil, nourri par l’immarcescible foi en la vie et en l’espérance. De la simplicité d’un sujet qu’on pourrait résumer en quelques lignes à peine, est né un roman aux teintes à la fois surannées et doucement imprégnées de la tristesse et de la fatigue de l’apitoiement. Le titre lui-même est comme un défi, celui de l’homme ou de la femme qui perpétue le sursaut et l’élan vers la vie, la force de continuer.
Romain Estorc
Stéphanie Janicot, Que tous nous veuille absoudre, Albin Michel, août 2010, 267 pages, 19 euros.


0 commentaire