Michel Jullien : Ballade entre la plume du copiste et la corde du pendu
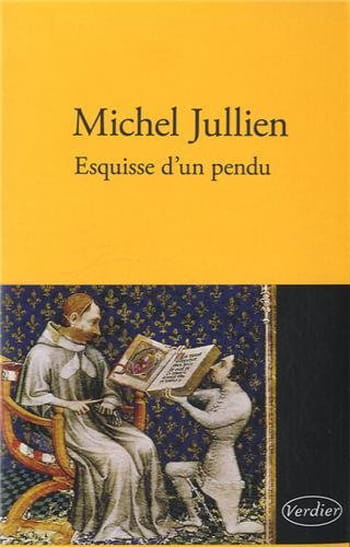
Cet homme a existé. Il a été copiste auprès de Charles V, dit le Sage, auquel les noms de Du Guesclin et Christine de Pisan se rattachent. On en a une preuve, grâce au « livre dit mireoir hystorial escript par Raoulet d’orliens, l’an mil trois ce[n]s quatre vins et seize, parfait / a dieu graces rendy, de juing le premier vendredy ». Homme étonnant, disions-nous. Ni gras ni gros ni grand, « calibré au-delà des normes…avec une tignasse de triomphe…ayant perdu de ses reflets acides, tirant vers le rubigineux », un homme au gabarit gigantesque, solidement « coffré », une sorte d’ours en somme. Nous avons un portrait en pied défiant les mensurations. « Eté, hiver, il s’enrobait d’une souquenille écrue, tachée d’encre, à manches mi-longues d’où dépassaient ses avant-bras tronconiques, à l’épiderme clair, chenus sans capillaire, couleur argile…au bout de quoi ballaient ses mains, deux phénomènes anatomiques, quasi deux kilos chaque, mouflées par l’habitude de l’écriture. »
On pénètre à sa suite dans un univers précis, codifié, assermenté, d’encre et de laize, de tranchoir et de vélin, dans un monde fermé sur sa science et ouvert sur le savoir des autres. Pendant qu’il aligne ses lettres et s’encanaille en escapades, Maroise en femme dévouée et avisée, s’active, tire les manuscrits du coffre, gère les approvisionnements, confectionne les cahiers. Des élèves apprennent à bien calligraphier, des scribes s’initient à « déjouer la bavure ». On produit environ quatre pages la journée.
Second décor, vaste toile de fond comme celle d’un opéra tragique dominé par la Machine. Il est planté quelque part entre l’actuelle gare de l’Est et les Buttes-Chaumont. Il s’agit du gibet de Montfaucon, immense structure tendue de morts, vaste et complexe armature dont Victor Hugo a laissé une saisissante description : « C'était un horrible profil sur le ciel que celui de ce monument ; la nuit surtout, quand il y avait un peu de lune sur ces crânes blancs, ou quand la bise du soir froissait chaînes et squelettes et remuait tout cela dans l'ombre. Dans ce profond charnier où tant de poussières humaines et tant de crimes ont pourri ensemble, bien des grands du monde, bien des innocents sont venus successivement apporter leurs os ». On pense à cette ballade célèbre :
La pluie nous a lessivés et lavés
Et le soleil nous a séchés et noircis;
Pies, corbeaux nous ont crevé les yeux,
Et arraché la barbe et les sourcils.
Jamais un seul instant nous ne sommes assis;
De ci de là, selon que le vent tourne,
Il ne cesse de nous ballotter à son gré.
Raoulet, bien sûr, quitte son atelier et se rend dans le quartier lugubre. Le lecteur n’a plus qu’à prendre pour guide cet armarius absolument incroyable, accepter de tantôt travailler avec lui, tantôt de marchander à la foire du Lendit, tantôt de cheminer à ses côtés jusqu’au gibet terrible. En compagnie des reliures et des registres, des cursives, des lectrins, des grimoires, des opisthographes, de tout ce qui relève de cette prodigieuse technique qu’est l’imprimerie, nous vivons le quotidien de Raoulet. Double aventure, qui en marge des fabrications d’ouvrages se tisse de menus événements et de vrais mystères. La valeur d’un parchemin est inestimable quand on sait de quoi il est fait ! Le suspens se noue autour de ce métier où tenir la plume signifie érudition et compter ses gains.
Michel Jullien manie le français du Moyen Age comme personne. Il prend un plaisir évident à employer des mots truculents, comiques, savants, inattendus, toujours adaptés au contexte. Il est un nouveau Rabelais. Pas de description sans cette verve des termes, une éloquence des vocables qui s’enchaînent, un emportement des phrases. « Alors il adopta cette posture qui lui parut la bonne : buste penché, croupe arrière, un coude sur la table, sa figure éclipsée à demi par une main plaquée en bandoulière, tenant à un bout le menton, barrant la bouche, rasant le nez à la diagonale, couvrant un œil entier, mourant au front, aux premières boucles de cheveux ». Son talent lui permet de jongler avec les signes comme avec un alphabet qu’il dessine adroitement. On pense à Queneau et sa poésie comique. « Les u ne sont rien mieux que deux i dont les queues se touchent infimement sans que leurs têtes soient en contact, les n sont deux i dont les cols s’effleurent quand leurs jambes s’ignorent, les m idem, les i sont des petits l encore et le r n’est pas plus qu’une sinusoïde de i frappé d’un délicat chignon. »
Soudain, rompant le flux du vocabulaire, émaillant la lecture de surprises, il glisse un mot moderne, l’ajuste à la situation, déjantant son propos en l’actualisant. Entre les jouvencelin, surcot, page liseronnée, huchier, groison, ragotin, s’infiltrent jet set, juke box, happening ou encore duty free et sudoku. Divertissantes, bondissantes, ces collisions de style sont son secret et sa marque. La limite est cependant atteinte, tout truc trop exploité s’affadit. Péché véniel qui n’émousse pas l’appétit. Il ne faut pas sauter de pages, comme le faisaient par mégarde les stationnaires, en pinçant deux feuilles à la fois. « Ne méfeuillez pas » ce livre, au risque de rompre le charme de cette ballade.
Dominique Vergnon
Michel Jullien, Esquisse d’un pendu, Verdier, janvier 2013, 185 pages, 16 euros



0 commentaire