Interview - Jacques Chancel : « Il ne faut pas donner au téléspectateur ce qu’il aime mais ce qu’il pourrait aimer »

Pour Jacques Chancel le moi est haïssable. Il se refuse à rédiger ses mémoires, mais a bien voulu écrire son dictionnaire amoureux de la télévision dans lequel il est tout entier, pionnier et passionné.
— Vous avez démarré dans le journalisme très jeune, en Indochine. Vous intéressiez-vous déjà à la littérature ?
J’ai écrit avant 20 ans deux romans – L’Eurasienne et Mes rebelles, aux Éditions Catinat, à Saigon – et un recueil de nouvelles.
J’ai fait une licence de droit, à Saigon, à laquelle je ne comprends rien. J’aurais voulu faire Normale Sup’, mais je n’ai pas pu me présenter puisque j’étais en Indochine. J’étais parti parce que j’avais le goût des ailleurs. Il est vrai aussi que j’avais un oncle qui était inspecteur général des forêts d’Indochine et ma tante, qui était également ma marraine, y était directrice générale d’un lycée. Ils revenaient tous les deux ans et me rapportaient toujours des chaussures à semelles de crêpe. Cela m’avait terriblement marqué. Je me disais qu’il fallait que j’aille plus loin. Je vivais dans les Pyrénées, à cent trente kilomètres de la mer que je n’avais jamais vue. En revanche, mon père m’a fait faire toutes les montagnes à vélo ! J’ai également fait beaucoup de marche à pied. Bref, il me fallait voir autre chose. J’aimais tellement mon pays que je voulais le comparer. Mon oncle m’a dit que, peut-être, la bonne solution serait l’Indochine.
Là-bas, j’ai tout fait. Je suis tombé sur une bande assez extraordinaire dont j’étais le bébé, puis que je n’avais même pas 20 ans : Lucien Bodard, Jean Lartéguy, Graham Greene, etc. J’ai eu une chance extraordinaire. Je le reconnais. Raymond Cartier m’avait nommé correspondant de guerre pour Match – et je travaillais en même temps pour Radio France-Asie. Chaque correspondant de guerre était affecté à une unité. Moi à la Légion étrangère, Lartéguy aux parachutistes… Nous étions à l’hôtel Continental de Saigon. De là, nous partions chaque semaine pour le camp de presse de Hanoï. Nous étions la plupart du temps en opération avec des troupes. Cela m’a peut-être donné la chance de pouvoir, par la suite, philosopher sur la vie. J’ai vu les saints et les salauds. Cela permet, surtout à l’âge le plus tendre, de vraiment réfléchir. J’ai été cruellement touché, comme beaucoup d’autres, sérieusement blessé. Aujourd’hui, on s’en souvient.
Nous avons récemment enterré Jean Lartéguy. Cela s’est passé aux Invalides. Tout d’un coup, on est venu nous chercher, Raoul Coutard, grand photographe qui a fait tous les films de Jean-Luc Godard, Pierre Schoendoerffer (1) et moi, en nous disant : « Premier rang. » Nous sommes les trois derniers survivants des correspondants de guerre d’Indochine.
— Quand êtes-vous rentré en France ?
Tout de suite après Diên Biên Phu. Arrivant dans les années 1960, je n’ai pas connu les pionniers de la télévision. Je ne savais d’ailleurs même pas ce qu’était la télévision ! Nous, c’était la radio. Nous émettions en trois langues : français, anglais et cantonais. Et nous avions plus de vingt millions d’auditeurs.
— Quand êtes-vous passé du grand reportage de guerre à la culture ?
Tout de suite. Lorsque je faisais ma licence de droit à la faculté de Saigon, on ne parlait pas beaucoup littérature. Plus tard, au cours d’une conférence à l’Alliance française, j’ai connu un type assez formidable qui était venu parler de Proust. Je ne savais pas qui c’était. À la fin de la conférence, je lui ai dit que j’aimerais le revoir. Il m’a répondu : « Peut-être un jour. » Quelque temps après, alors que j’étais affecté à la Légion étrangère, un colonel m’a invité à dîner. Au cours du repas, je me suis retourné pour voir l’homme qui me servait : c’était celui de cette conférence. Un légionnaire. Il était issu d’une grande famille dont je tairai le nom. Je l’ai beaucoup fréquenté, à la seule condition que je ne révèle pas qui il était.
— Mais lorsque vous avez « rencontré » Proust, vous aviez déjà écrit deux romans…
J’avais déjà beaucoup lu. Mon père m’a tout fait lire. Il avait d’ailleurs essayé de me faire lire Proust, mais je n’y arrivais pas. Dès les cinquante premières pages, j’arrêtais. J’ai commencé comme tout le monde par Dumas, Balzac… Tout ce qui était romanesque. Et tout cela faisait de moi un lecteur. Puis, petit à petit, mon père étant très habile, il m’a entrainé ailleurs. Et j’ai été élevé par la lecture. On ne sait pas assez quel est le bonheur de la lecture.
Je ne suis pas du tout pour le numérique, même si nous y sommes condamnés, car je trouve qu’il n’y a pas d’érotisme. J’écris avec mon feutre, pas autre chose. Et je vais sans arrêt dans les librairies, alors que je reçois quinze ou vingt livres par jour. D’ailleurs, dans les librairies, je suis affolé. Je me demande comment on peut avoir tant de livres. Qui va acheter tout ça ? Dernièrement, je suis resté à parler avec un libraire environ trois quarts d’heure. Et pendant ce temps, il n’y a pas eu un achat !
— À quel âge avez-vous commencé votre journal intime ?
À 15 ans. Mais cela ne fait qu’environ trente-cinq ans que je le publie.
— Une
partie est donc inédite !
Oui. Elle ne sera jamais publiée. Mes enfants, je le sais, respecteront ça. J’ai des centaines, pour ne pas dire des milliers, de cartons. Je note. Je raconte toutes mes histoires.
Je parle souvent de l’Indochine dans mes livres, évidemment, mais je n’avais pas encore raconté mon histoire. Et là, je me suis fait piéger en signant chez Flammarion un livre qui s’appelle Hôtel Continental. Tout est venu du fait qu’un jour, ma fille m’a proposé de regarder ce qu’il y avait dans une de mes malles. Il s’agissait de carnets. J’en ai ouvert un, qui concernait l’Indochine, et j’ai trouvé cette phrase, que je connais désormais par cœur : « J’ai tout connu, j’ai tout vécu, j’ai tout souffert ; aujourd’hui, avec un brin de suffisance, je me dis que mon existence est finie : j’ai 24 ans. » Comme je ne veux pas rédiger mes mémoires à proprement parler, je vais écrire mes vingt-quatre premières années, ce qui va me permettre de parler des Pyrénées, de Saigon, de ce que j’ai vécu là-bas… Cela va être difficile à raconter, parce que cela a été extraordinaire. Par exemple, les deux premiers mois, d’une manière romantique, j’avais envie de suicide. Mais j’ai été sauvé par une dame formidable, qui était la patronne des IPSA, les infirmières pilotes secouristes de l’air. Sur dix, six étaient des aristocrates. Des filles d’une beauté ! C’est elle qui m’a redonné goût à la vie.
Sachez que j’ai refusé pendant deux ans d’écrire le Dictionnaire amoureux. J’adore cette collection, qui est pour moi la plus belle qui existe actuellement, mais je ne voulais pas y participer parce que je savais que c’était un piège : vous avez l’obligation de dire « je » et d’aller jusqu’à vos souvenirs.
— Vous le faites pourtant dans votre journal !
Oui, mais ce n’est pas pareil. C’est mon journal.
— Les textes que vous publiez sont-ils une version édulcorée de ce que vous écrivez au quotidien ?
Oui ! Un jour, j’en ai parlé à Julien Green. Je lui ai demandé s’il pensait que cela intéressait quelqu’un de savoir qu’il avait eu la diarrhée… Et il m’a répondu : « Oui, parce que moi, je suis écrivain. »
Pour ma part, je n’ai pas envie de parler de moi. Mais en fait, en parlant des autres, je ne parle que de moi. Le piège se referme à chaque fois.
— Quand on écrit une biographie, ou lorsqu’on réalise une longue interview, on se parle finalement à soi-même…
Tout à fait. « Radioscopie », c’était une radioscopie de moi-même. Toutes les questions que je posais, c’était pour avoir des réponses que je n’avais jamais obtenues de moi.
« Radioscopie » a été un moment assez extraordinaire. Mon idée de départ était simple : je voulais, chaque jour, pendant une heure, parler avec quelqu’un. Romain Gary m’a dit que cela ne durerait pas, enfin, deux mois à tout casser, parce que selon lui, il n’y avait pas plus de cinquante personnes intéressantes en France. Sur les 6 826 « Radioscopie », j’ai reçu 1 500 anonymes. Des bergers dans les Pyrénées, des forgerons… Et à chaque fois, il y a eu un vrai dialogue.
— Vous êtes-vous retrouvé un lundi matin sans personne ?
Non. Jamais. Et je dirais même que je trouvais autant d’intérêt avec un anonyme, un inconnu, qu’avec Sartre.
— Vous deviez être énormément sollicité par les attachées de presse !
Oui. Mais je sélectionnais. Il était hors de question, comme pour « Le Grand Échiquier », qu’un chanteur, par exemple, vienne me dire qu’il sortait un album et qu’il voulait que je l’invite.
— « Le Grand Échiquier », c’est ce que l’on a fait de mieux jusqu’à maintenant…
Un plateau, du direct… Cela durait de deux heures trente à cinq heures, ce qui n’est plus possible aujourd’hui. Et maintenant, dans tous les débats, on coupe la parole.
— Comment se fait-il qu’aujourd’hui, le service public ne soit pas capable de proposer une émission comme « Le Grand Échiquier » ?
Pour refaire une émission comme celle-là, il faudrait un président qui ait de l’audace, un animateur qui ose prendre des risques, qui soit assez modeste pour ne pas croire qu’il va être le héros de son émission, qui ait du temps… et qui ait un rendez-vous. Il y a quelques rendez-vous, comme « Envoyé spécial », « Des racines et des ailes »… Mais en dehors de ces quelques émissions, tout le reste est dispersé. Récemment, en allumant la télévision un soir, j’ai constaté que sur trois chaines, il y avait trois émissions de variétés, et que les mêmes chanteurs y étaient invités. On frise le ridicule !
— On pourrait imaginer que le service public soit moins regardant quant à l’audimat !
Tout le problème est là. De nos jours, si vous diffusez une émission un soir et que vous avez une réunion le lendemain matin, personne ne dira si cela a été bon ou mauvais : tout le monde s’interrogera sur les chiffres. Et toutes les décisions se prennent en fonction de la réponse à une seule question : « On a fait combien ? » Selon les scores, on garde ou on jette. Et ça, ce n’est pas possible.
Mais attention, cela ne veut pas dire non plus qu’une émission qui fait dix millions de téléspectateurs est minable… ou qu’une émission qui fait cinquante mille téléspectateurs est géniale.
— Vous avez dit qu’une soirée opéra à la télévision rassemblera plus de personnes devant la télévision qu’il n’y aura de personnes qui iront à l’opéra en France.
Évidemment. Avec Marcel Jullian, nous avons créé Antenne 2 de toutes pièces, et nous avons fait vingt-cinq opéras. Lorsqu’un opéra recevait un million de téléspectateurs, ce qui n’était rien par rapport à une émission de variétés, nous nous disions que jamais Garnier ne connaîtrait une telle fréquentation !
Dans le cas d’une télévision privée, affichée comme commerciale, je ne discute pas : on procède différemment. Alors que sur une télévision publique, il faudrait vraiment se donner de la liberté. Mais pas pour n’importe quoi ! Il y a des émissions qui se veulent tellement « intello » qu’elles sont inaudibles. C’est un jeu très serré que celui de la télévision. C’est un vrai métier. Or, des personnes arrivent sans avoir de métier ; on leur fait endosser des habits qui ne leur conviennent pas, et ensuite, lorsque ça ne marche pas, on les jette ! C’est le grand problème.
— Vous êtes parti en guerre contre ceux qui pillent l’INA.
Il y a des gens qui n’ont aucune honnêteté. J’ai vu des émissions entièrement faites de nos images, des Carpentier ou des miennes, signées « une émission de… ». Je n’avais jamais vu ça avant ! C’est du vol manifeste. Je suis pour la création, pour l’imagination.
Par ailleurs, j’ai toujours dit qu’il ne faut pas donner au téléspectateur ce qu’il aime mais ce qu’il pourrait aimer.
— Cela devrait être la même chose dans l’édition.
Oui, mais on ne le fait plus. Toutefois, l’édition est particulière puisque c’est un marché. Si vous êtes éditeur, vous voudrez tout de même que vos livres fonctionnent. Alors que la télévision publique, c’est différent.
— Mais il peut y avoir un certain nombre de livres qui se vendent bien et permettent aux éditeurs, parallèlement, de prendre des risques…
Il y a tout de même des éditeurs qui procèdent ainsi. Mais c’est vrai qu’on regarde d’abord quelles sont les ventes.
Trois livres viennent de sortir dans la collection « Dictionnaire amoureux » chez Plon. Avant moi, c’était Xavier Darcos, avec le Dictionnaire amoureux de la Rome antique. Ensuite, il y a moi. Puis il y a Philippe Alexandre avec le Dictionnaire amoureux de la politique. Or, les ventes ne sont pas les mêmes. Le sujet de la Rome antique est un sujet difficile. Alors que c’est drôle, bien fait… je dirais même que c’est populaire. Mais c’est comme ça. C’est un sujet qui fait peur.
— Si l’on regarde les rentrées littéraires du début du siècle précédent, les livres étaient tout de même d’un autre niveau !
Certes, mais tout était à un autre niveau, et on ne pourra juger que, peut-être, dans cinquante ans. Par exemple, j’aurais adoré recevoir Picasso et Matisse ! Avoir Ravel et Debussy ! Y a-t-il aujourd’hui un Ravel et un Debussy ? Un Picasso et un Matisse ? Seule la postérité le dira. Mais moi qui suis un fouineur de musées, de galeries – puisque je suis un fou de peinture –, je ne trouve pas celui qui pourrait être ce génie-là. Pour autant, je me trompe surement.
C’est l’histoire de Stchoukine et Morozov, deux industriels russes installés à Saint-Pétersbourg, avec une fortune colossale, qui sont arrivés à Paris en 1905, qui ont fait un tour des galeries et sont repartis avec deux cent cinquante tableaux, dont Picasso et Matisse, qui n’étaient alors pas connus. Aujourd’hui, ce qu’il y a à L’Hermitage est le fruit de leurs découvertes.
Je dois avouer que sur l’art contemporain, je suis très faible. J’ai des amis qui collectionnent du contemporain. Mais lorsque je les vois collectionner, je me dis qu’ils n’aiment pas ce qu’ils collectionnent. Ils le font parce qu’ils se disent que cela va être formidable… Mais après tout, c’est leur problème. Et ils ont les moyens de le faire !
— Quels sont votre plus beau et votre pire souvenir en matière d’interview télévisée ou radiophonique ?
Je n’ai pas de pire souvenir. Quels que soient les gens que je recevais, je m’amusais.
D’autre part, il est très difficile de dire le meilleur. Je vais par exemple vous donner trois noms, et si vous m’interrogez demain, je vais vous en donner trois autres. Pour autant, il est vrai que des gars comme Genevois, Lévi-Strauss, Sartre, Brassens, Ferré ou Brel m’ont beaucoup apporté.
— Vous est-il déjà arrivé que quelqu’un quitte le plateau ?
Non. Jamais. Il y a pourtant eu des drôleries. Comme nous étions totalement en direct, il se passait parfois des choses insensées. Par exemple, un jour, alors que nous étions en pleine émission avec un orchestre symphonique de cent vingt musiciens, un orchestre de jazz de cinquante musiciens et quatre cents personnes sur le plateau, Michel Serrault s’était installé sous un piano à queue avec un réchaud à gaz et se faisait cuire des œufs au plat. La peur de l’incendie ! Si l’émission avait été enregistrée, on ne l’aurait pas passée : cela mettait en cause toute la sécurité ! Le lendemain, dans la presse, tout le monde rigolait. Mais les services de sécurité m’en ont voulu pendant des mois.
Une autre fois, avec l’orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Karajan, après le premier mouvement d’un concerto de Mozart, le pianiste, malade, quitte le plateau, alors que trois mouvements étaient prévus. Je vis un drame. Et que vois-je ? Karajan, qui n’avait plus joué depuis trente ans, qui se met à la place du pianiste.
C’était comme ça. La surprise. Il y avait une vie. Et comme il y avait cette disponibilité complète, c’était assez extraordinaire. Dans ce métier, il faut être disponible. Aujourd’hui, d’abord, les animateurs ont des oreillettes. En régie, il y a un gars qui lui suggère « Ne dis pas ça », « Fais une phrase assassine »… Et ils ont des fiches !
— Écrivez-vous de la fiction ?
Non. On m’a pourtant commandé des pièces de théâtre. Mais je ne m’en sens pas capable. Pourtant, j’aimerais beaucoup. J’ai deux idées. Florian Zeller m’a demandé à quel moment j’allais m’y mettre. À 32 ans, il a déjà écrit sept pièces de théâtre. C’est extraordinaire. Moi, ce n’est pas que je suis à sec, au contraire, mais je suis peureux. Je manque d’audace.
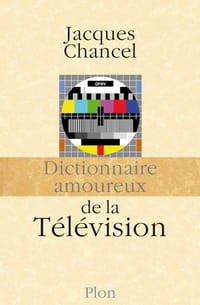
Propos recueillis par Joseph Vebret
(Décembre 2011)
© Photo : Frederic Souloy-Gamma Rapho
Jacques Chancel, Dictionnaire amoureux de la télévision, Éditions Plon, octobre 2011, 711 p., 16 €
(1) Pierre Schoendoerffer est décédé le 14 mars 2012, quelques semaines après la réalisation de cet entretien.


3 commentaires
Jacques Chancel est décédé le 23 décembre 2014.
on est triste.
Un homme remarquable.