La fête de l'ours, un conte sauvage
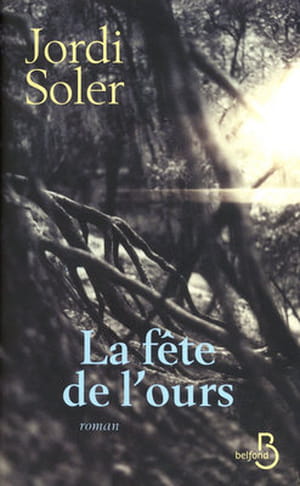 A la recherche du grand-oncle perdu
A la recherche du grand-oncle perduDans ce roman assez bref, Jordi Soler s’aventure dans l’autobiographie mâtinée d’autofiction pour nous entraîner dans une quête des origines complexe, tortueuse, sauvage : on se plaît à découvrir à sauts et à gambades une enquête, au sens tant moderne qu’étymologique du terme. Cette histoire tantôt paisible, tantôt effrayante, ressemble à un conte déconstruit, au goût amer.
L’ombre de Grimm
L’auteur nous parle de guerre, et plus précisément, de la fin de la guerre civile espagnole des années trente : le narrateur évoque le souvenir d’Oriol, son grand-oncle soi-disant disparu, mort dans la mythologie des uns, menant une carrière de pianiste concertiste en Argentine pour les autres. Le récit procède par enchâssements, par retours en arrière, par avancées soudaines, par ellipses : les outils les plus complexes de la narration nous aspirent dans un tourbillon de prolepses et d’analepses, caractéristique d’une grande qualité d’écriture, d’une conduite de l’histoire qui ne saurait céder au simple besoin du suspens ou du retournement de situation, mais qui se permet avec talent d’épouser le cahoteux chemin de la mémoire. Le narrateur doit composer avec des témoignages oraux, des archives quasi-muettes, et surtout, cette châpe de plomb qui recouvre dans le roman les petits villages frontaliers des Pyrénées et de la région d’Argelès-sur-Mer, propre à l’omertà qui s’impose lorsqu’un étranger s’immisce avec curiosité dans l’intimité des autochtones.
Ce sont justement ces personnes colorées, vivantes, hors du commun, qui font lentement glisser le récit dans l’univers du conte : le géant un peu innocent, Novembre Mestre, peut-être le seul « héros » au sens propre de cette histoire, mais encore la rebouteuse du village, plus instruite qu’on ne le croit, la vieille sarcastique qui déclenche le processus de la recherche, ou bien le fameux Oriol, dont le véritable destin fut de devenir un bandit unijambiste, hirsute et sale, apparaissent comme des figures surnaturelles. Leur bestialité, leur portrait brut, confèrent un je-ne-sais-quoi de merveilleux, de fantastique, dans cette forêt enneigée et cette montagne balayée par les vents d’hiver. Les personnages rencontrés par le narrateur, fussent-ils sympathiques ou touchants, irritants ou repoussants, se situent à la frontière de l’humanité, en adéquation avec cette frontière inaccessible que tentent de rejoindre Républicains et autres réfugiés dans la débâcle, dans la diaspora annonciatrice des temps terribles à venir. Certains épisodes, on en révèlera un seul, semblent sortis de la noirceur de l’inconscient des contes : lorsqu’Oriol commet l’irréparable, lui qu’on croyait décédé, et qui en vérité fut sauvé du froid par le géant, l’auteur trouve des accents nouveaux, qui extraient la narration de la routine autobiographique, pour atteindre à la pure fantaisie, à la fable véritable : non seulement par le renoncement au « je », mais aussi par la peinture d’un croque-mitaine qui en franchissant le seuil d’une petite propriété au fond des bois, où survivent deux petites filles, franchit le seuil de son humanité. La sorcière d’Hansel et Gretel a abandonné la maison aux petites filles, mais un monstre humain vient frapper à la porte, au pas claudiquant, à la béquille meurtrière.
La fête de l’os
Se permettra-t-on un jeu de mots ? Le titre espagnol du roman, La Fiesta del oso, pourrait s’entendre comme La Fiesta del hueso, « la fête de l’os ». Ossements blanchis, « purs », de l’enfant assassiné, ossements des combattants républicains morts de froid, ossements symboliques qui suggèrent la mort, celle de certains protagonistes dans cette histoire. L’auteur nous peint un narrateur qui découvre l’ignominie du comportement de son ancêtre à la vie jadis rêvée, fantasmée, et qui devient une vie réelle, effroyable. L’écriture, en même temps qu’elle accède au langage du conte, révèle cette part de réalité qui fut occultée par la famille du narrateur, opérant un chiasme très complexe : l’imaginaire familial déroulait un récit fort prosaÏque, tandis que la vérité historique se pare des oripeaux du conte. Pour subvenir aux exigences d’une narration aussi subtile, le romancier déploit un arsenal stylistique particulièrement soigné : on se plongera avec délices dans des phrases très longues, à la fois reflets du courant de conscience du narrateur, et pourvoyeuses du vertige du verbe, comme de celui de la montagne où se réfugia Oriol. Là encore, dans cette abondance de scories verbales, de tortueuses réflexions, ne verra-t-on point un cimetière de la pensée, un ossuaire de l’espoir, une catacombe de l’esprit, pour le narrateur déçu, aigri, tourmenté par la vérité ?
Le titre de l’œuvre fait référence, on le découvre vers la fin du roman, à une légende pyrénéenne, celle d’un ours qui aurait gentiment ravi une jeune fille, l’aurait fait vivre avec lui dans sa grotte, avant d’être capturé, rasé, recouvert de goudron, et finalement « humanisé » par une foule vengeresse. Conte cruel, qui donne lieu à une sorte de fête votive, de foire, chaque année. Le narrateur dévoile l’ultime vérité lors d’un parcours difficile, chemin de croix au sein d’une foule joyeuse aux intempestifs accents de la liesse insouciante. L’auteur parvient avec brio à soutenir le rythme lancinant de la marche, à faire battre à la fois le cœur angoissé du narrateur et les tambours de la fête : ce sacre, ce rite populaire, accède en l’espace de quelques lignes au mythe, et la conclusion s’impose brutalement, tétanisante, comme une révolution, comme un cycle absurde et cruel.
On ne trahira pas le secret de cette fin abrupte, de cet accord final fracassant, discordant, cathartique : de la terreur et de la pitié qui soudain jaillissent au terme du voyage, on retiendra la remarquable et splendide étude de l’auteur sur les ténébreux mystères de l’humain.
Romain Estorc
Jordi Soler, La fête de l'ours, traduit de l'espagnol par Jean-Marie Saint-Lu, Belfond, janvier 2011, 216 pages, 18 euros.





0 commentaire